- Les sociétés pré-littéraires et antiques conçoivent un temps cyclique, faits d'éternels recommencements, où le passé informe le futur parce qu'il lui ressemblera.
- Le temps chrétien brise ce cycle en introduisant la notion d'une fin à l'histoire, le Jugement dernier. Le temps devient linéaire et unidirectionnel.
- Les philosophes des Lumières et les positivistes du 19e siècle introduisent un temps moderne, qui constitue une seconde cassure entre le passé et l'avenir: le futur sera nécessairement différent du passé parce que les êtres humains utiliseront la raison pour changer le monde pour le mieux. Le passé peut toujours informer l'avenir, mais d'une manière négative: on cherche dans le passé des erreurs à ne plus reproduire.
- Le temps post-moderne rompt avec l'optimisme du précédent et nie quelque lien intelligible que ce soit entre le présent et le passé. Dans le meilleur des cas, l'accélération des changements fait en sorte que même le passé récent devient un étranger qui ne peut plus informer le présent ou permettre de pronostic concernant l'avenir. Dans le pire des cas, des catastrophes comme l'Holocauste ou la Seconde guerre mondiale prouvent que le "progrès" assumé au 19e siècle, loin d'être inévitable, est improbable et hors de notre contrôle. Les leçons du passé sont inutiles parce que rien dans l'expérience antérieure ne permettait d'anticiper ou d'expliquer de tels désastres.
Engendré par de graves traumatismes, cette perception post-moderne du temps est sans doute exagérée mais elle impose tout de même un devoir d'humilité à la pratique historienne. Si les questions posées au passé peuvent légitimement être inspirées par les préoccupations du présent, il n'est pas clair que l'on puisse tirer de l'expérience passée des leçons directement applicables. Prudence...
(1) : Reinhart Koselleck, "Champs d'expérience et horizon d'attente: deux catégories historiques", dans Le futur passé. Contributions à la sémantique des temps historiques, Paris, Éditions de l'EHESS, 1990, p. 307-329.
(2) : François Hartog, "Ordres du temps et régimes d'historicité", dans Régimes d'historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Éditions du Seuil, 2003, p. 11-30.
(3) : Jean Chesnaux, "Les temps et le temps: un objet philosophique singulier", dans Habiter le temps. Passé, présent, futur: esquisse d'un dialogue politique, Paris, Bayard, 1996, p. 97-116.
(4) : Antoine Prost, "Les temps de l'histoire", dans Douze leçons pour l'histoire, Paris, Éditions du Seuil, 1996, p. 101-123.
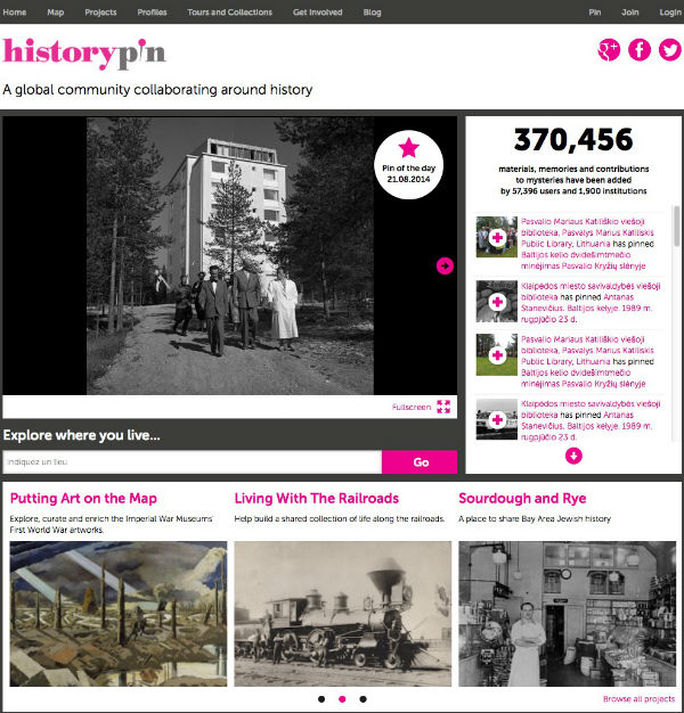

 Flux RSS
Flux RSS
